
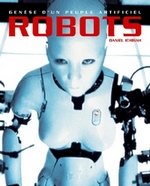
Extrait du livre Robots, génèse d'un peuple artificiel
Daniel Ichbiah
Un robot du 21ème siècle, c'est quoi au juste ?

Un super-ordinateur logé dans un corps mobile, capable de fonder ses actions de manière raisonnée sur ce qu'il perçoit du monde extérieur.
Ajoutons un détail : dans l'imagerie populaire, cet être artificiel a spontanément une forme humaine. Qu'il soit géant ou nain, il semble qu'il ait vocation à devenir androïde. Tout se passe comme si l'Homme cherchait inlassablement à créer un double de lui-même dont il aurait idéalement maîtrise de la destinée.
Cette quête visant à simuler la vie est vieille de plusieurs millénaires et a progressivement intégré les techniques de diverses époques, de l'horlogerie à l'électronique. Avant d'en arriver aux androïdes intelligents du 21ème siècle, il a fallu franchir bien des étapes…
Ils ont eu pour nom Ctésibios, Vaucanson ou Walter Grey… Un à un, ces ingénieurs se sont acharnés à susciter un mouvement harmonieux ou prédictible dans un objet d'humaine manufacture.
Guidés par la fascination de la chose animée et l'apparence de vie qui semble en découler, ils ont conçu des formes et leur ont donné un souffle, une gestuelle, des actions prévisibles.
Durant plusieurs millénaires, les automates ont reposé sur des ressorts, engrenages et autres mécanismes, ce qui ne les a pas empêché d'atteindre une grâce qui force l'admiration. Et puis l'informatique est venue changer la donne en permettant de stocker de très larges quantités d'informations et de séquences d'actions dans une petite puce. Le robot est ainsi arrivé à une sophistication telle qu'il peut désormais tenter de trouver par lui-même la solution de certains problèmes.
L'histoire des robots a ainsi traversé les étapes suivantes :
Telle est l'histoire du robot… Quant à sa mission, elle paraît inscrite dans son étymologie.
Celui qui a pour la première fois employé le terme en 1923, l'écrivain tchèque Karel Capek ne l'a pas choisi au hasard (voir chapitre 2 : Les robots dans la fiction).
Dans sa langue natale, "robota" signifie "serviteur", "travailleur asservi"… Le sort de la créature est ainsi jeté.
Au fond, le rêve de l'Homme ne serait-il pas, au travers d'une telle progéniture auxiliaire, de développer une race de serviteurs consentants et heureux de leur sort, qu'ils assument des tâches ingrates ou partent en éclaireur pour assouvir l'humaine soif de découverte ?

L'origine des masques et statues animés remonte à l'Egypte ancienne où l'on a recensé un masque à l'effigie de Thot (tête d'Ibis) ou d'Horus (tête de faucon) qui pareillement semblent doués de mouvement. Ce qui caractérise ces divers artefacts, c'est que l'automatisme y est caché, mis à profit par des castes religieuses pour assurer leur pouvoir sur le peuple comme sur les souverains.
Les miracles opérés par les prêtres pour impressionnants qu'ils aient pu paraître à leurs contemporains étaient dus à leur maîtrise de facteurs relevant de la mécanique. L'ouverture des portes d'un temple, l'animation du bras de la statue du Dieu Amon suite aux paroles prononcées par l'oracle, reposaient vraisemblablement sur la dilatation de l'air chauffé par le feu " sacré ", phénomène qui comprimait l'eau et l'amenait à s'écouler, actionnant alors un ensemble de cordes de poulies. Un même principe peut aisément expliquer le lait qui semblait mystérieusement jaillir des multiples seins de la déesse Artémis.
Pour retrouver la trace d'automates s'affirmant ouvertement comme tels, il faut remonter vers 380 avant J.C. Un ami du philosophe grec Platon, Archytas de Tarente, aurait fabriqué un pigeon de bois, qui à en croire certains récits, tournait sur lui-même - une rotation probablement opérée par des jets d'air comprimés.
Passons outre ces phénomènes qui relèvent du subterfuge ou de légendes souvent non accréditées pour nous immiscer dans les préoccupations des hommes de science d'alors. Dès l'Antiquité, une notion semble les fasciner, celle de la régularité du temps. Depuis le cœur qui bat la mesure avec constance jusqu'aux saisons qui s'enchaînent selon les positions du soleil, l'Univers semble opérer selon un modèle cadencé. Pour mesurer l'écoulement du temps en toutes heures du jour et de la nuit, un instrument voit le jour, la clepsydre, qui en assure un repérage approximatif par l'écoulement de l'eau.
C'est en 246 avant J.C. que nous trouvons la trace du premier inventeur d'envergure, un dénommé Ctésibios qui habite la ville d'Alexandrie. Ctésibios est parvenu à créer une horloge si précise que son cadran fait exactement un tour par année solaire ! Pour la première fois, il existe une parfaite concordance entre un instrument de mesure humain et un phénomène issu du monde physique extérieur.

Le génial Ctésibios ne s'arrête pas en si bon chemin. Dans la foulée, il construit d'autres machines dont une sert à faire de la musique, ancêtre de l'orgue de Barbarie. Cet étrange appareil repose sur une combinaison de flux d'eau, de pompes, contrepoids, soupapes et pistons, reliés à une dizaine d'aulos (instrument à vent) - d'où son nom d'alors, l'hydrolaus.
Sa renommée gagne les contrées alentours. Lors d'un séjour en Asie mineure en 78 avant J.C., le philosophe et orateur politique romain Cicéron s'extasie sur les sonorités de l'hydrolaus qu'il assimile à une "délicate friandise". À Rome, l'instrument s'impose comme un objet de luxe indispensable aux festivités.
À l'autre bout de la planète, du côté de la Chine une même soif d'animer les objets se réveille. Entre 140 et 87 avant J.C, l'empereur Wou aurait transformé un " palais en théâtre comportant une machinerie d'opéra : bateleurs, jongleurs, équilibristes animaient des scènes cosmiques où intervenaient des bêtes étranges, naturelles ou artificielles . "
Lors du 1er siècle, Héron d'Alexandrie, un mathématicien et mécanicien grec rédige un traité relatif aux automates et désacralise au passage les miracles antiques en expliquant comme ils ont été rendu possibles par une connaissance de phénomènes physiques et hydrauliques. Avant tout, Héron pose les principes essentiels à la confection d'automates - notamment la force élastique et motrice des gaz soumis à l'action de la chaleur et de la pression.

Les arabes sont les premiers à mettre en pratique à une grande échelle les techniques décrites par Héron d'Alexandrie (et aussi par Phylon de Byzance). Dès 809, Charlemagne reçoit de la part du sultan Haroun Al Rachid un automate mécanique.
Puis, lors des huit expéditions en Orient menées à l'occasion des Croisades - de 1096 à 1291 - les européens découvrent de visu l'étonnant raffinement des horloges à eau réalisées par Al Jazari pour le compte de ce même Haroun Al Rachid. On y voit des oiseaux qui laissent échapper de leur bec des billes qui tombent sur des cymbales, des musiciens qui jouent de la trompette, des portes qui s'ouvrent pour révéler des silhouettes humaines…
Pour obtenir un écoulement constant de l'eau, Al Jazari a développé un système d'une rare ingéniosité, inspiré d'un système inventé par Archimède. La plus grande de ses horloges mesure 3,3 mètres de hauteur et 1,35 mètres de largeur.
Est-ce l'exemple d'Al Jazari qui inspire les horlogers de France une fois les chevaliers revenus au pays ? Toujours est-il que la fin du Moyen Âge voit fleurir au sommet des tours les " jacquemarts ", personnages de plomb ou de fonte qui viennent sonner les cloches selon un temps qui retentit dans la cité et rythme son activité sur une même mesure. La plus ancienne de ces horloges à automates est construite en 1351 à Ovietto en Italie. Parfois, comme à Cluny en France, le sommet de la tour fait apparaître de véritables scènes religieuses animées. Tandis qu'un ange salue la Vierge, une colombe descend, symbole du Saint Esprit et le Père vient bénir ses créations. D'une certaine façon, de telles réalisations visent à impressionner les paysans qui fréquentent les églises et demeurent pantois vis-à-vis de scènes dont ils ignorent totalement les fondements mécaniques.
Au moment de la Renaissance, les automates de divertissement deviennent monnaie courante dans les demeures des privilégiés. Un grand nombre d'attractions reposent alors sur des principes hydrauliques. Dans la galerie du château d'Hesdin (Picardie) où aiment à séjourner les comtes de la région, des automates distribuent des coups de bâton et des machines soufflent des poudres blanches à la figure des convives amusés. Vers l'an 1500, Louis XII se fait fabriquer un lion mécanique, capable de marcher, de s'arrêter et aussi montrer les armoiries de France, sur ordre du Roi. Une telle création est représentative de l'inventivité dont font preuve les artisans français.
Le haut lieu de l'automation n'est autre que le château de Saint-Germain-en-Laye, résidence des souverains de France d'alors. Il abrite des grottes truffées de machineries hydrauliques conçues par l'ingénieur florentin, Thomas Francini et vouées au divertissement des nantis. En 1598, dans son Traité de l'Homme, Descartes les décrit ainsi : " Entrant dans quelques-unes des grottes de ces fontaines, les étrangers causent par eux-mêmes, sans y penser, les mouvements qui s'y font en leur présence, car ils n'y peuvent entrer qu'en marchant sur certains carreaux, disposés de façon telle que s'ils approchent d'une Diane qui se baigne, ils la feront cacher dans des roseaux ; s'ils passent plus loin pour la poursuivre, ils feront venir vers eux un Neptune qui les menacera de son trident ; s'ils vont de quelqu'autre côté, ils en feront sortir un monstre marin qui vomira de l'eau contre la face ou choses semblables selon le caprice des ingénieurs qui les ont faites. " D'autres décriront une mer sillonnée de poissons et soudain agitée par le tonnerre qui soulève les eaux, suivi d'un changement de décor, faisant apparaître le Dauphin descendant du ciel dans un char.

Le 18ème siècle apparaît comme l'âge d'or des automates. L'un des grands inventeurs d'engins mécaniques de l'époque est le protégé du roi Louis XV, Jacques de Vaucanson (1709 - 1792). Le rêve que poursuit cet automaticien de génie serait de reconstituer un homme artificiel. À défaut d'y parvenir, il développe un " canard mécanique " qui force l'admiration. Celui ci " allonge le cou pour aller prendre le grain dans la main, l'avale, le digère " Après avoir transformé l'aliment en bouillie, il le rejette par les voies ordinaires, pleinement digéré. Les créations que réalise Vaucanson tels le joueur de flûte qui exécute onze airs différents et aussi celle de ses disciples séduisent l'Europe entière et s'exportent aux Etats-Unis.
Le concept du programme modifiable à volonté va naître au sein de l'industrie du tissage. La mode veut que l'on s'habille à la chinoise, avec des tenues de soie bardées de motifs complexes. Pour les tisserands lyonnais, la réalisation de telles étoffes représente un casse-tête de taille : la richesse des figures amène à manipuler un nombre énorme de cordelettes auxquelles sont reliées des aiguilles.

Dans la ville de Lyon, le tisserand Basile Bouchon se penche sur le problème. La chance veut que son père soit un fabricant d'orgues. Bouchon réalise qu'il devrait être possible d'adapter l'un des mécanismes utilisé au sein de ces instruments - un cylindre muni de chevilles - aux machines à tisser. Son mécanisme utilise une bande de papier perforé pour contrôler le passage des aiguilles dans le tissu.
Le principe est simple : s'il y a un trou, l'aiguille passe à travers et sinon elle se relève. Ce procédé mis au point en 1729 est automatisé par Vaucanson en 1745.
Le tisserand Joseph-Marie Jacquard a ensuite l'idée de séparer les cartes perforées portant le modèle à réaliser, de la machine elle-même.
Produit en milliers d'exemplaires, le métier à tisser Jacquard qu'il inaugure en 1801 devient la première machine automatisant le traitement de l'information et opérant une distinction entre la machine et le programme qu'elle utilise. Il ouvre ainsi la voie aux ordinateurs et robots capables d'opérer par eux-mêmes.

À la même époque, l'horloger suisse Pierre Jacquet-Droz aidé de son fils Henri-Louis réalise trois automates d'allure humaine. L'un d'eux peut dessiner avec une finesse digne d'un artiste, un autre, une jeune fille joue du clavecin tout en observant tour à tour ses mains et sa partition, avant de faire sa révérence à la fin du morceau (1773). La troisième poupée androïde, le Scribe, peut tracer de sa plume en caractères élégants le texte demandé, d'une longueur de 40 caractères (1774). Les automates de Jacquet-Droz sont réalisés d'une façon tellement perfectionnée que certains, en Espagne, iront jusqu'à l'accuser de sorcellerie et demander son arrestation. Parmi les automatistes de renom de la même époque figure le Baron Von Kempelen, ingénieur hongrois créateur d'un joueur d'échecs aussi impressionnant que controversé : un humain était-il caché dans le dispositif ?
Les montres du 18ème siècle tentent de reproduire à une échelle miniature la complexité des grandes horloges. Des couples de jacquemarts de taille réduite apparaissent sur les cadrans et se voient baptiser " Martin et Martine ". Ces petits bijoux animés remportent une popularité telle que d'objets de luxe, ils deviennent courants, obligeant les horlogers à rivaliser d'astuce, multipliant les scènes animées en modèle réduit.

Vers le milieu du 19ème siècle, la vogue des automates est devenue mondiale. Au Japon, à Osaka, le théâtre de poupées mécaniques (appelés karakuri en japonais ) de Takeda Omishojo remporte un tel succès que son nom est associé au genre. On parle de " takeda-karakuri ". Au même moment en Europe, une mode se développe, celle de l'automate magicien, qui réalisent des tours dignes de Robert Houdin (1805 - 1871), l'homme qui a révolutionné l'univers de la magie en intégrant des procédés de mécanique et d'horlogerie dans ses tours. Prisés de la société bourgeoise, ces automates magiciens entrent en lévitation, escamotent des objets, avalent des boules et vont jusqu'à prédire l'avenir.
Une étape majeure dans le chemin qui va mener jusqu'aux robots est franchie en 1854 lorsque le professeur George Boole du Queen's College de Cork en Irlande fonde le système mathématique qui porte son nom. L'algèbre booléenne ne connaît que deux valeurs, 0 et 1. De par la simplicité de ses bases, le système de Boole ouvre la porte à une représentation formelle de la logique et donc à la conception d'une machine douée de raisonnement, l'ordinateur…
À partir des années 1900, l'engouement du public pour les automates se restreint et c'est le monde de la publicité qui en fait le plus grand usage. En 1909, la vitrine du grand magasin parisien " Au Bon Marché " montre la découverte du Pôle Nord par le Commandant Robert Peary. D'autres automates posés sur un socle, attirent l'attention du badaud en frappant sur la vitre du magasin.
Au même moment, les premières entités assimilables aux futurs robots font leur apparition. Le chien électrique de Hammond et Miessner (1915) est attiré par une lumière et en ce sens, il se distingue d'un simple automate par le fait qu'il est doté d'un organe sensoriel (un capteur) recueillant des informations de l'extérieur, et capables d'influencer son comportement. L'espagnol L. Gonzalo Torres construit un grand nombre d'appareils opérant de manière "automatique" - le mot est de son invention - dont un joueur d'échecs mécanique capable de jouer les trois derniers coups d'une partie.
Aux alentours des années 40, une évolution majeure se produit : l'électronique vient prendre la place des rouages mécaniques, par essence lents et peu maniables. L'électron que le danois Niels Bohr a décrit dans ses travaux publiés vers 1913 a pour propriété de se déplacer d'un atome à l'autre une vitesse vertigineuse : plusieurs milliers de kilomètres à la seconde. D'où l'idée de créer des circuits exploitant cette incroyable mobilité. En 1937, dans un article appelé à faire date, Des nombres calculables, Alan M. Turing énonce les principes d'une machine qui calculerait à la vitesse de l'électronique, et serait donc capable de traiter d'énormes volumes d'informations codées sous la forme booléenne (0 et 1). Turing est persuadé qu'une telle machine manipulant des symboles pourra tôt ou tard résoudre tous les problèmes qui lui seront soumis et donc se comparer au mental de l'Homme. L'arrivée des ordinateurs est appelée à jouer un rôle majeur dans l'élaboration des machines intelligentes que sont les robots.
Le premier ordinateur digne de ce nom est inauguré en février 1946 à l'université de Pennsylvanie.
Ce tyrannosaure de l'informatique porte le nom d'ENIAC.
Il nécessite un local de 140 mètres carrés, pèse 30 tonnes, comporte 18.000 tubes à vide, nécessite de manipuler des commutateurs et de brancher plusieurs centaines de câbles.
Il n'en sera pas moins utilisé pendant près de quinze ans à l'université de Harvard à Boston.

Alors que le milieu du vingtième siècle se profile, une invention essentielle est effectuée par William Shockley et John Bardeen : celle du transistor, un petit composant qui permet de diriger et réguler le courant électrique. Il arrive à point nommé à une époque où déjà l'on se préoccupe de réduire la taille des ordinateurs. Dès 1950, plusieurs transistors sont intégrés au sein d'une petite plaque de silicium, une corps simple présent dans la nature sous forme de silice (autrement dit de sable) : le circuit intégré est en train de voir le jour.
Sous l'impulsion de Turing, un premier ordinateur apparaît en 1943. Sa puissance de calcul est mise à contribution dans la guerre et joue un rôle décisif en facilitant le décryptage du code Enigma mis au point par les nazis pour leurs échanges de messages.
La seconde guerre mondiale voit également les américains comme les germaniques se livrer une lutte contre la montre pour arriver le premier à la possession de l'arme atomique. C'est à cette occasion qu'apparaissent les premiers "bras" de télé-opération à distance. Les substances radioactives étant particulièrement dangereuses pour l'homme, il est nécessaire de les faire saisir par des pinces reliées à un système de tringles et de poulie. Un opérateur protégé par une épaisse paroi de verre manipule ainsi les éléments radioactifs à distance.
C'est en Lorraine en 1954, à Argonne qu'un chercheur du nom de Raymond Goertz a l'idée de rationaliser les bras de télé-opération en assujettissant leurs articulations à des moteurs électriques. Grâce à un tel système, l'opérateur peut désormais se trouver à plusieurs centaines de mètres du lieu où il manipule des éléments dangereux : les commandes qu'il transmet à la pince sont transmis par les fils électriques. Le concept des bras robotisés n'est plus très loin.
(...)
Extrait du chapitre 1 de Robots genèse d'un peuple artificiel : L'histoire des robots.